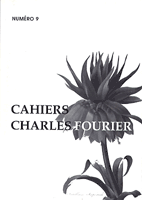
Marquée par la reconnaissance ambivalente de Marx et Engels, la pensée de Charles Fourier a très vite été reléguée, par les théoriciens marxistes, au rang des doctrines désormais stériles : le socialisme utopique, sans aucun doute précurseur, était par là même irrémédiablement dépassé par le socialisme scientifique. La raison fondamentale du mépris du fouriérisme par les marxistes réside dans l’idée même d’utopie, véritable repoussoir pour toute pensée politique. L’utopie, en effet, semble indéfectiblement entachée par la double faute de l’irréalisme et du tropisme totalitaire. Toutefois, c’est oublier un peu vite que Fourier est précisément l’auteur qui permet de récuser une conception aussi réductrice de l’utopie. C’est sans doute pourquoi les principales figures du marxisme hétérodoxe (Bloch, Marcuse, Benjamin) ont su retrouver Fourier à partir de Marx et par-delà Marx ou, en tout cas, par-delà ce « quelque chose qui manque » à Marx.
« On ne lit plus Fourier parce que tous ceux qui pensent avec leur temps, en avant de leur temps, lisent Marx, Engels, Lénine et Staline ».Félix Armand, Actualité de Fourier (1953)
Charles Fourier appartient, avec Saint-Simon et Robert Owen, à la première génération des socialistes anté-marxistes classés très tôt par Marx et Engels dans la catégorie des « grands utopistes » [1]. Certes, les socialistes utopiques font partie de la « classe dominante » et leurs « protestations ne trouvent au début absolument aucun écho dans la masse exploitée » [2]. Toutefois, outre que Marx et Engels se disent à maintes reprises redevables de ces premiers socialistes, ils marquent une estime toute particulière à l’égard de Fourier : « leurs allusions, leurs références et même leurs recours à sa caution sont nombreux tout au long de leur œuvre » [3]. Marx notamment, jusque dans ses lettres, exprime avec une grande constance la préférence qu’il accorde à Fourier, jugé plus « profond » [4] que les autres utopistes. Or, passée cette reconnaissance due aux Pères du socialisme, le marxisme s’est développé, jusqu’à une période récente, dans l’oubli, le rejet ou le mépris de l’œuvre de Fourier. Tout s’est passé comme si, par delà les propos de Engels en faveur du penseur bisontin, la tradition marxiste avait retrouvé le peu de considération d’un Dühring parlant de Fourier comme d’un « indicible imbécile » soutenant des « idées que l’on s’attend plutôt à trouver dans les asiles d’aliénés » [5].
Il convient de reconnaître que ce « rêveur sublime », comme le désigne Stendhal, a délibérément choisi, dans son entreprise de refondation sociale, ce qu’il nomme lui-même, l’« écart absolu ». Fourier, qui se présentait comme un « sergent de boutique illitéré » [6], ne propose, en effet, aucune réforme politique visant à supprimer les injustices sociales : il affiche, bien plutôt, un programme de « contestation globale » [7].
Pourtant, en dépit d’une réception erratique et de disciples infidèles, Fourier a bénéficié de quelques thuriféraires de talent dans divers courants de l’histoire des idées, à l’exception notable du marxisme. De fait, pour la plupart des marxistes, Fourier est un penseur à ranger parmi ces « alchimistes sociaux » [8] dont on ne peut rien espérer, sinon des chimères intellectuelles et des désordres politiques. En dépit du parrainage ambigu de Marx et de Engels, les marxistes paraissent donc avoir « manqué » Fourier. Comment comprendre une telle absence de la pensée sociétaire, pendant une période aussi longue, chez les auteurs se réclamant du marxisme ?
L’effet séculaire d’une reconnaissance ambivalente : socialisme scientifique contre socialisme utopique
Sans qu’il nous soit ici possible de revenir à la lecture faite par Marx et Engels de l’œuvre de Fourier, il importe de rappeler leur critique fondamentale du socialisme utopique : la pensée des utopistes repose sur le désirable en société et non sur une analyse dialectique du procès objectif de la société, c’est-à-dire, in fine, des conditions sociales et économiques.
Leurs inventions personnelles doivent suppléer ce que le mouvement social ne produit point ; les conditions de l’émancipation prolétarienne, c’est l’histoire qui les donne, mais ils préfèrent les tirer de leur imagination ; à l’organisation graduelle et spontanée du prolétariat en classe, ils veulent substituer leur fiction d’une organisation de la société. En forgeant leurs plans, ils ont pourtant conscience de défendre avant tout l’intérêt de la classe la plus misérable, de la classe laborieuse. Et c’est sous ce seul aspect de la souffrance extrême que le prolétariat existe pour eux. [9]
Autrement dit, les anticipations et les prescriptions des utopistes se font à l’écart du mouvement réel de l’histoire, parfois même s’opposent à lui, comme le revendiqueront d’ailleurs les surréalistes plus tard. À l’inverse, Marx veut donner au communisme des fondements scientifiques et, ce faisant, tente de cerner les possibles au sein de la réalité sociopolitique, de délimiter les points de rupture du système capitaliste : quand le discours marxiste est objectivement porté par l’histoire, l’utopie n’est, pour sa part, que l’un des nombreux effets du déroulement historique des conditions matérielles d’existence.
L’analyse des socialistes utopiques par Engels, en 1878, dans un des chapitres de l’Anti-Dühring – chapitre réédité dès 1880 séparément sous le titre Socialisme utopique et socialisme scientifique – s’est avérée déterminante pour la réception marxiste de la pensée sociétaire. Au demeurant, la conjonction de coordination présente dans le titre de l’opuscule annonce clairement la dichotomie : il faudra choisir, désormais, entre deux formes de socialisme. Non que Engels soit méprisant à l’égard des utopistes mais, si son analyse est souvent pertinente, elle est aussi sélective et orientée, puisque rédigée en vue de répondre aux critiques malveillantes de Dühring à l’encontre du socialisme. La stratégie d’écriture de Engels consiste ainsi à souligner ce qui, dans les doctrines des utopistes, anticipe et parfois annonce la venue du socialisme véritable, à savoir la critique marxiste du capitalisme. Le pli, si l’on peut dire, était pris.
Bien qu’Engels n’ait jamais prétendu à l’exhaustivité, son essai délimita de fait les paramètres au sein desquels allaient travailler des générations d’historiens. L’important corpus soviétique d’écrits sur Fourier dérive encore à ce jour des idées et des expressions contenues dans cet essai ou dans le Manifeste du parti communiste. De même, la plupart des marxistes d’Europe de l’Ouest n’envisagent la pensée de Fourier et la question de ses rapports avec celle de Marx et de Engels qu’à l’intérieur des cadres définis par Engels. [10]
Dès lors, les théories du socialisme utopique apparaissent comme une phase préparatoire destinée à mener au socialisme scientifique de Marx et Engels, lesquels ne reconnaissent les travaux salutaires de leurs prédécesseurs que pour mieux affirmer les avoir dépassés en un mouvement qui interdit tout retour en arrière. Depuis les travaux de Arthur E. Bestor [11] et de Felix Armand [12] jusqu’à ceux de E. J. Hobsbawm [13], en passant par ceux de Zil’berfarb [14], tous les historiens bienveillants à l’égard du fouriérisme présenteront désormais Fourier comme un précurseur de Marx et de Engels, mais aussi, dans le même geste, comme un penseur nécessairement dépassé par le marxisme. Félix Armand illustre parfaitement cette attitude dans l’entre-deux-guerres français, et même un peu au-delà. Il publia en effet, à l’occasion du centenaire des révolutions de 1848, un ouvrage sur le fouriérisme des années 1850, dans lequel il eut cette formule si caractéristique pour évoquer le passage de Fourier à Marx : « Morte l’utopie, le socialisme scientifique était né » [15]. On pourrait ainsi multiplier les cas remarquables de relégation de Fourier par les penseurs marxistes, quand il ne s’agit pas d’oubli pur et simple. Ainsi, dans L’État et la Révolution (1917), Lénine cite pas moins d’une soixantaine d’auteurs (dont Proudhon), alors que Fourier n’est pas mentionné une seule fois. Il y eut certes de rares et brèves tentatives de faire sortir Fourier du mépris dans lequel il était tenu au cours des premières décennies du XXe siècle. Charles Rappoport, par exemple, membre influent du Parti Communiste Français des années 1920 et responsable de la formation des militants, insiste sur la valeur des socialistes utopiques [16]. Mais la tentative tourne court : Rappoport est marginalisé dès 1924, avant de quitter le parti peu après.
Les années 1970 ont pu laisser croire à un revirement vis à vis de la pensée fouriériste. Il est vrai que le début de cette décennie constitue « ce moment où l’on revient à Fourier comme à l’élan ingénu qui sous-tend la pensée socialiste » [17]. Tout le monde, ou presque, semble retrouver Fourier, et s’y retrouver. L’ouvrage de Dominique Desanti, publié en 1971, constitue un révélateur remarquable de ce regain d’intérêt pour le « grand contestataire » [18].
Toutefois, cet attrait soudain du fouriérisme a été aussi éphémère que vif et, surtout, ne paraît pas avoir entrainé un intérêt politique véritable au sein de la gauche, notamment marxiste. Dans son ouvrage sur La Gauche en France depuis 1900, Jean Touchard peut ainsi écrire, en 1977, que « seul un petit noyau de fidèles, étrangers d’ailleurs aux grands partis de gauche, s’intéresse à Fourier et à son rêve, assez fascinant, d’une petite communauté exemplaire d’où pourrait partir une réforme globale de la société » [19].
Bien entendu, la réception politique de Fourier n’épuise pas la pensée du « poète-mathématicien », comme l’appelait Queneau. D’une part, en effet, les idées de Fourier se sont diffusées par bien des canaux au sein de la société, en France et ailleurs [20]. Il est difficilement niable qu’il y a eu, depuis près de deux siècles, une lente imprégnation du fouriérisme dans tous les milieux, ceux de la pédagogie par exemple (avec des figures décisives comme Jean Macé) ou, plus récemment, ceux de la sociologie de la sexualité [21]. D’autre part, les idées de Charles Fourier se sont explicitement développées dans les mouvements coopératifs dont la diffusion est étudiée depuis longtemps, même si le mouvement fouriériste sous le Second Empire et la Troisième République a longtemps été négligé avant les études de Bernard Desmars [22]. Par ailleurs, les écrivains, on le sait, ont loué, pour nombre d’entre eux, l’univers et la langue de Fourier. Outre Breton et les poètes surréalistes qui en firent un usage notable, Fourier a marqué de son empreinte nombre de grandes œuvres littéraires : de Stendhal à Klossowski, en passant par Hugo, Balzac, Flaubert et Zola, pour ne mentionner ici que des écrivains français, son influence sur la littérature ne s’est jamais démentie [23].
On dira peut-être que l’intérêt du mouvement coopératif et la fascination croissante de la poésie pour la pensée de Fourier n’ont pu que desservir l’ambition de ce dernier à refonder entièrement la société et, de surcroît, confortent d’une certaine manière les détracteurs marxistes du socialisme utopique. Ces derniers pourraient d’ailleurs, dans cette perspective, mentionner des auteurs qui ont trouvé en Fourier les motivations suffisantes pour s’éloigner des principes marxistes les mieux établis et produire des doctrines dissidentes : la pensée libertaro-marxiste de Daniel Guérin, le freudo-marxime de Wilhem Reich ou même le féminisme marxisant d’Alexandra Kollontaï. Ces auteurs, à la fois issus du marxisme et, en même temps, définitivement éloignés de lui, semblent ainsi donner raison aux marxistes orthodoxes qui récusent la compatibilité des théories de Fourier avec celles de Marx.
Le marxisme évalué à l’aune du socialisme utopique de Fourier
Plus intéressants, dans la question qui nous occupe, sont les marxistes hétérodoxes qui, sans rompre avec les fondements de la théorie, ne peuvent toutefois se satisfaire du marxisme dominant et nourrissent leur apport critique au socialisme par une relecture des utopistes, de Fourier en particulier. Ernst Bloch, Herbert Marcuse et Walter Benjamin sont, à n’en pas douter, les chefs de file de cette catégorie au demeurant fort peu représentée.
Ernst Bloch conteste très tôt la vulgate marxiste et en particulier, pour le dire de manière cursive, son matérialisme historique en ce qu’il prétend opposer rigidement la base économique de la société, soumise à un déterminisme objectif, à la superstructure, simple écho de l’infrastructure dans la conscience subjective. Bien au contraire, l’idéologique, selon Bloch, intervient immanquablement dans la combinaison des forces matérielles de manière presque indiscernable. C’est dans cet esprit que Bloch s’est intéressé à la Guerre des Paysans, c’est-à-dire aux révoltes paysannes inspirées par Thomas Munzer au début du XVIe siècle.
Au-delà de leurs aspects économiques, il convient de considérer les soulèvements paysans dans leurs plus profondes racines. Si l’on veut saisir réellement les conjonctures et les virtualités de l’époque, il faut nécessairement tenir compte, à côté des facteurs économiques, d’un autre besoin et d’un autre appel. Car si les appétits économiques sont bien les plus substantiels et les plus constants, ils ne sont pas les seuls ni, à la longue, les plus puissants […]. Quel qu’il soit, l’état du mode de production, en tant que disposition d’esprit économique, dépend déjà par lui-même de complexes psychologiques et moraux plus vastes qui exercent, en même temps leur action déterminante. [24]
En somme, pour l’exprimer dans les termes blochiens, « etwas fehlt ». Il manque quelque chose dans le marxisme, un « quelque chose » que les socialismes utopiques avaient, selon Bloch, déjà perçu avant même, paradoxalement, l’avènement du marxisme.
Concernant Marcuse, on comprend dès ses premières œuvres combien l’homme du « grand refus » ne pouvait manquer d’intérêt pour l’homme de l’« écart absolu ». Marxiste pour la vie, comme il dit, Marcuse ne parvient toutefois pas à comprendre les développements historiques du XXe siècle dans le cadre théorique du marxisme, tel qu’il est alors compris et enseigné. En particulier, Marcuse revient sans cesse, dans son œuvre, à cette incompréhension dont il est parti dès les années 1930 : l’effondrement de la classe ouvrière la plus politisée d’Europe face au fascisme hitlérien. À la lumière du déclin du socialisme en Europe occidentale entre 1920 et 1930, Marcuse se demande si le matérialisme historique ne s’est pas trompé sur les conditions de l’émergence de la conscience de classe. Ses doutes apparaissent dans sa réflexion Sur le problème de la dialectique (1930) : à cause du caractère abstrait du concept de classe historique, le marxisme n’a pas vu les potentialités mobilisables de chaque individu pour une politique de gauche et ne s’est pas suffisamment interrogé sur les moyens de développer ces potentialités. De nouveau, rapporté au matérialisme historique orthodoxe, le phénomène politique ne laisse pas d’apparaître insoluble et Marcuse en déduit, lui aussi, que « quelque chose manque » au marxisme. Découvrant, en 1932, les Manuscrits de 1844, Marcuse trouve partiellement chez le jeune Marx les problèmes qu’il cherchait à résoudre dans le marxisme, tout en tirant la leçon de l’histoire récente que la classe ouvrière n’est plus, désormais, le moteur de la révolution. Le freudisme, certes, permettra à Marcuse de trouver d’autres critères de mouvements révolutionnaires qui tiennent compte de l’individu et de ses caractéristiques les plus quotidiennes. Cependant, avec la parution de L’Homme unidimensionnel (1964), Marcuse divulgue enfin son inspiration clairement fouriériste puisque la thèse générale de cet ouvrage fameux consiste à soutenir que la rationalité technologique organise tous les domaines et activités du corps social, dans leurs moindres détails, afin qu’ils obéissent aux principes idéologiques essentiels à la productivité matérielle.
On perçoit en quoi cette thèse entre en résonance avec celles de la théorie critique. Au reste, dès 1937, dans « Philosophie et théorie critique » [25], Marcuse montre que les concepts de la théorie critique sont particulièrement « constructifs », c’est-à-dire capables de saisir une réalité à supprimer au moyen d’une réalité substitutive, procédé théorique proche de celui de Charles Fourier. Par ce biais au moins, Walter Benjamin pouvait difficilement échapper à l’attrait de la pensée sociétaire. Klossowski en témoigne lorsqu’il évoque sa rencontre avec Walter Benjamin, en compagnie de Breton et de Bataille.
Nous l’interrogions [Walter Benjamin] avec d’autant plus d’insistance sur ce que nous devinions être son fond le plus authentique, soit sa version personnelle d’un renouveau phalanstérien. Parfois, il nous en parlait comme d’un "ésotérisme " à la fois "érotique et artisanal", sous-jacent à ses conceptions marxistes explicites. La mise en commun des moyens de production permettrait de substituer aux classes sociales abolies une redistribution de la société en classes affectives. Une production industrielle affranchie, au lieu d’asservir l’affectivité, en épanouirait les formes et en organiserait les échanges ; en ce sens que le travail se ferait le complice des convoitises, cessant d’en être la compensation punitive. [26]
Nous ne pouvons ici développer la conception de Benjamin d’une rénovation du marxisme à l’aune du principe d’espérance. Relevons seulement que la place prise par Fourier au sein de la pensée benjaminienne est de plus en plus reconnue, tant l’utopie sociétaire a su intégrer le matérialisme anthropologiquement élargi que Benjamin a cherché à promouvoir [27]. On pourra s’en convaincre, en particulier, au moyen de la liasse « W » [28] de Paris, capitale du XIXe siècle [29] qui révèle la présence souterraine, mais continue, de Fourier dans la philosophie de Benjamin. Ainsi en va-t-il, par exemple, de la critique avancée par Benjamin à l’encontre de la conception du travail qui a fini par s’imposer, dès le programme de Gotha, au sein des partis ouvriers allemands.
Chez les ouvriers allemands, la vieille éthique protestante du travail réapparut sous une forme sécularisée. Le programme de Gotha porte déjà les traces de cette confusion. Il définit le travail comme "la source de toute richesse et de toute culture". À quoi Marx, animé d’un sombre pressentiment, objectait que celui qui ne possède d’autre bien que sa force de travail "est nécessairement l’esclave des autres hommes, qui se sont érigés […] en propriétaires". Ce qui n’empêche pas la confusion de se répandre de plus en plus, et Josef Dietzgen d’annoncer bientôt : "Le travail est le Messie des temps modernes. Dans l’amélioration […] du travail […] réside la richesse, qui peut maintenant accomplir ce qu’aucun rédempteur n’a accompli jusqu’à présent". Cette conception du travail, caractéristique d’un marxisme vulgaire, ne prend guère la peine de se demander en quoi les biens produits profitent aux travailleurs eux-mêmes, tant qu’ils ne peuvent en disposer. Elle n’envisage que les progrès de la maîtrise sur la nature, non les régressions de la société. Elle présente déjà les traits technocratiques qu’on rencontrera plus tard dans le fascisme. Notamment une approche de la nature qui rompt sinistrement avec les utopies socialistes d’avant 1848. Tel qu’on le conçoit à présent, le travail vise à l’exploitation de la nature, exploitation que l’on oppose avec une naïve satisfaction à celle du prolétariat. Comparées à cette conception positiviste, les fantastiques imaginations d’un Fourier, qui ont fourni matière à tant de railleries, révèlent un surprenant bon sens. Si le travail social était bien ordonné, selon Fourier, on verrait quatre Lunes éclairer la nuit terrestre, les glaces se retirer des pôles, l’eau de mer s’adoucir, les bêtes fauves se mettre au service de l’homme. Tout cela illustre une forme de travail qui, loin d’exploiter la nature, est en mesure de l’accoucher des créations virtuelles qui sommeillent en son sein. [30]
De la récusation toute théorique des adversaires de l’utopie aux problèmes concrets posés par l’utopiste
D’où vient alors, que la pensée marxiste, en dehors de ces trois grandes figures marxiennes, se soit aussi peu attachée à l’étude de l’œuvre de Fourier, et ce en dépit du crédit que les fondateurs du socialisme scientifique avaient été pourtant disposés à lui porter ? On peut d’abord envisager, bien entendu, que les raisons ayant permis l’occultation de Fourier dans l’histoire des idées en général, jusqu’à une date récente, ont pu valoir pour les penseurs marxistes comme pour les autres. Même si l’on exclut l’argument des admirations dérangeantes chez un socialiste comme Fourier [31] ou celui de son antisémitisme virulent [32], on peut identifier de nombreuses raisons de la désaffection à son égard depuis le caractère baroque de sa doctrine jusqu’au cliché de l’impraticabilité de ses théories en passant par ses procédures formelles fantasques, son allégorisme universel stupéfiant, ses méthodes analogiques, sa manie numérologique, son érotologie sociale ou sa pédagogie choquante.
Nous ne pouvons, à l’évidence, minorer l’importance de toutes les difficultés propres à l’œuvre de Fourier et souvent étudiées par les commentateurs : elles expliquent en partie sa difficile réception dans la pensée contemporaine en général et, par conséquent, dans la pensée marxiste en particulier. Toutefois, on peut aussi considérer que la « laborieuse » réception marxiste de Fourier trouve également sa source dans la distinction originaire entre socialisme utopique et socialisme scientifique, distinction qui a abouti, en dépit de la reconnaissance due aux anciens, à la disqualification du premier. René Schérer considère, dans une jolie formule, qu’« une erreur d’optique a fait ranger Fourier, selon la célèbre définition de Marx, parmi les socialistes utopiques » [33]. Formule pertinente car ce n’est pas tant le classement lui-même qui a été néfaste à la postérité de la pensée de Fourier, que la perspective dans laquelle il a été opéré [34]. Comme l’écrit Sami Naïr, « il y a deux façons de définir le socialisme utopique : soit par rapport au socialisme scientifique, soit par rapport à l’Utopie elle-même » [35]. Or, dès le départ, la présentation de Fourier s’est inscrite dans le cadre marxiste et s’est diffusée à partir de lui. On peut, à bon droit, y voir « la raison de l’extrême discrétion, à la remarquable exception de Bloch, de la tradition marxiste envers lui : on enregistre le grand ancêtre et on laisse en repos la dérangeante modernité, dont on n’a guère l’usage » [36]. Ainsi, paradoxalement, par delà l’hommage, faire de Fourier un précurseur « utopiste » du marxisme, était le plus mauvais service que l’on pouvait rendre à sa pensée.
Il faut croire, d’ailleurs, que les utopistes avaient senti le piège si l’on en juge par l’usage qu’ils font bien souvent du terme « utopie ». Quand il n’est pas utilisé comme une insulte, il fonctionne comme un repoussoir. Pour cette raison, Fourier se considère sans la moindre parenté intellectuelle avec les « utopistes » Owen et Saint-Simon [37]. Et il en va de même pour Proudhon, lequel se moque de surcroît des fouriéristes, alors que Marx considère Proudhon comme le continuateur médiocre de Fourier. Dès sa genèse, le socialisme voit donc en l’utopie son péché originel et l’érige en parfait épouvantail théorique.
Or, la question que l’on peut désormais poser – ou reposer, après les travaux précurseurs de Bloch ou de Benjamin – est de savoir si le marxisme ne pourrait se nourrir, pour son plus grand bénéfice théorique, des socialismes utopiques et, plus spécialement, de Fourier. Non plus penser après Fourier à partir de Marx, mais revenir à Marx en pensant avec Fourier, pour plagier un titre fameux. La question ou l’enjeu, en effet, n’est pas de réhabiliter Fourier, de le sortir de son « grenier » [38]. À ce titre, la balance à laquelle certains avocats zélés de Fourier s’essaient en tentant d’équilibrer les fantasmes les plus délirants par les prémonitions clairvoyantes du « rêveur sublime » est, somme toute, assez vaine. Que Fourier ait pu prophétiser qu’il ne faudra un jour que deux heures pour rejoindre Marseille depuis Paris, qu’on pourra produire de la limonade en utilisant de l’eau de mer, qu’il sera loisible de faire pousser des oranges à Varsovie ou que l’humanité parviendra à réchauffer la calotte glaciaire, est sans doute remarquable et dénote déjà, on peut en convenir, une capacité prédictive finalement moins farfelue qu’on a longtemps pu le croire. Toutefois, là n’est pas l’essentiel. Il est beaucoup plus intéressant pour le philosophe soucieux du politique, de constater la coïncidence entre les deux problèmes fondamentaux posés par Fourier et les enjeux les plus cruciaux de notre modernité sociale.
Le premier problème fondamental de Fourier, en effet, réside dans la spoliation des richesses que produit le corps social par le « commerce » (au sens large que lui donnait Fourier : banqueroute, agiotage, parasitisme, accaparements divers) et dans sa critique concomitante des « nouvelles féodalités », entendons des baronnies de la finance. Spoliation que le « garantisme », à la fois système de protection sociale (coopératives communales, minimum salarial, urbanisme contrôlé, pensions diverses, pensions d’invalidité en particulier) et période intermédiaire entre la Civilisation et l’Harmonie, ne saurait amender : le garantisme, s’il ouvre bien la voie au futur régime sociétaire, ne saurait répondre pour autant à la loi de l’attraction passionnée et assurer le bonheur humain. Et il y a moins de salut encore à attendre du côté de nos beaux principes républicains sur lesquels Fourier ne manque pas d’ironiser.
[…] une fraternité, dont cependant les coryphées s’envoient tour à tour à l’échafaud, une égalité, où le peuple qu’on décore du nom de souverain n’a ni travail, ni pain, vend sa vie pour cinq sous par jour, est traîné à la boucherie, la chaîne au cou [39].
Le second problème fondamental de Fourier, indissociablement lié au premier, porte sur la jouissance amoureuse limitée de chacun, en Civilisation, par des relations matrimoniales étriquées qui imposent ennui pour les uns et servitude pour les autres [40]. Il est ainsi urgent d’élaborer une critique constructive du « système oppressif des amours » [41]. Cette « prophétique tendance de Fourier à faire valoir les droits de la passion » [42] se rencontre aujourd’hui, comme on peut le constater, dans tout le champ de la théorie et de l’action politiques. Mais la pathocratie associative de Fourier est surtout un fanal théorique pour nous rappeler que les passions, avant même de pouvoir structurer l’ordre sociétaire, expliquent, en raison de leur « engorgement », l’échec général de la Civilisation : les passions sont par essence politique, telle est la grande leçon que les sociétés contemporaines sont en train de recevoir de Fourier. En cela, le penseur français n’est nullement le précurseur de Marx puisque, à l’encontre de l’auteur du Capital, il tente de concevoir comment créer un mécanisme de désaffection interne à la société à partir des seules mesures du plaisir et de la seule force des passions. Pour autant, cette raison ne saurait interdire le recours à Fourier pour interroger Marx ; au contraire, car la question est bien de savoir si l’analyse marxiste, justement, ne pourrait être renouvelée, sinon complétée, par un usage pertinent des conceptions fouriéristes.
Première objection fondamentale contre l’utopie : son nécessaire irréalisme
Puisque les deux problèmes fondamentaux que pose Fourier recoupent les préoccupations cardinales des sociétés contemporaines, comment comprendre, par delà les raisons évoquées précédemment, que sa pensée inspire si peu les marxistes contemporains ? Il nous semble que la question, indépendamment même de la grille de lecture téléologique imposée par Marx et Engels, croise immanquablement celle de la méfiance à l’encontre de l’utopie. Que reproche-t-on ordinairement, en effet, aux utopies socialistes en général, à Fourier en particulier ? Au bout du compte, toujours la même chose : leurs projets chimériques qui ne peuvent, en raison de la violence faite au principe de réalité, que déboucher au mieux sur un échec programmé, que conduire au pire à la naissance monstrueuse d’un totalitarisme quelconque, revendiqué ou non.
Certes, on peut se débarrasser, au prix de quelques ambages, du discours utopique au motif que l’utopie est une projection imaginaire sans lendemain véritable. Ainsi, Simone Goyard-Fabre affirme que « les utopies socialistes n’apportent guère de lumière à la philosophie politique » [43] et, plus généralement, condamne l’utopie sans appel : « quelle que soit la complexité du phénomène utopique, il n’est qu’un index pointé vers une créativité qu’il est incapable d’assumer » [44].
C’est oublier un peu vite que Fourier a répondu par avance à cette conception indigente de l’utopie et du rapport que cette dernière entretient avec le possible. Tout d’abord, l’impossible est devenu le prétexte automatique permettant de discréditer toute idée originale : « l’impossible, écrit Fourier, est le bouclier des philosophes, la citadelle des pauvres d’esprit et des fainéants. Une fois cuirassé du mot impossibilité ils jugent, en dernier ressort, de toute idée neuve » [45]. Ensuite, l’utopie de Fourier, faut-il le redire, n’est pas celle de Cyrano de Bergerac, de Rabelais, ni même celle de More, pour cette raison simple que la création du phalanstère est conçue comme réalisable dans la société du moment, au moyen de ses propres forces. Pour reprendre, la distinction fameuse de Lewis Mumford, toute critique de l’utopie suppose ainsi une distinction entre « utopies de fuite » et « utopies de reconstruction ». L’utopie de Fourier ne saurait se confondre avec la projection onirique de la société dans un quelconque futur ou un possible ailleurs, mais doit se comprendre comme une force capable d’opposer l’immensité de nos désirs aux constructions fragiles du politique et aux nécessités cruelles de l’économie.
Toute la difficulté, en l’espèce, consiste à circonscrire la signification exacte du concept d’utopie, trop souvent renvoyé au mythe. Or, pas plus qu’il ne se rapporte au rêve, au délire ou au roman politique, l’utopie a peu à voir avec le mythe, comme y insiste Miguel Abensour [46]. Ce dernier a bien montré, à partir de la controverse entre Adorno et Benjamin, combien l’utopie décroche du mythe précisément par sa capacité d’éduquer l’homme à ce que nous pourrions appeler, en dépit de la lourdeur de la formule, le « pas-encore-là-mais-déjà-réel ». Benjamin considère en effet l’utopie, « tel le geste de l’enfant qui apprend à saisir en tendant la main vers la lune, comme une anticipation excessive, mieux, comme étant toujours en excès » [47]. En ce sens, pour reprendre une formule de Breton, l’utopie ne parle jamais que de « l’autre monde qui est inclus dans celui-ci » [48] et n’en parle, précisément, que pour nous dire qu’il est déjà présent ; simplement, il est entravé et, plus grave encore, invisible. Il est remarquable, au demeurant, que Marx et Engels définissent le communisme en des termes fort proches de cette conception.
Pour nous, le communisme n’est pas un état de choses qu’il convient d’établir, un idéal auquel la réalité devra se conformer. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l’état actuel des choses. Les conditions de ce mouvement résultent des données préalables telles qu’elles existent actuellement. [49]
Ainsi Ernst Bloch peut-il affirmer que l’utopie n’est pas un genre littéraire, entendu comme une classe uniforme de textes. À la vérité, seule l’intention utopique est invariante au sein des utopies [50]. Quelle est cette intention ? C’est une fonction, celle de détecter des possibilités empêchées par l’ordre social existant. Elle est donc bien moins une anticipation qu’une détection ou une mise à jour de possibles et, les repérant, les désignant, les délimitant, de permettre d’activer ces virtualités. La distinction est ici capitale : est utopique, non pas tellement ce qui est irréalisable, mais ce qui est rendu irréalisable par un ordre social établi. Mieux encore, est utopique ce que cet ordre social rend tout bonnement impossible, pour la plupart des hommes, à concevoir ou à accepter.
Certes, l’utopie de Fourier, comme beaucoup d’autres, peut paraître s’enfermer dans des conceptions doctrinaires et se perdre dans des rêveries sublimes ou des visions terrifiantes. Mais ce serait perdre de vue l’essentiel, à savoir que la force vive de l’utopie réside surtout dans le mouvement de son propre dépassement. Pour reprendre Blanchot, « il ne faut s’adresser à Fourier que comme à un auteur inépuisable, débordant son propre système » [51]. C’est cette capacité remarquable qui lui permet l’identification de nouvelles possibilités contrariées du réel, des possibilités que cette identification, précisément, rend actives. Elles deviennent alors agissantes, fissurant déjà les fondations les mieux établies de l’ordre existant. Inversement, la Civilisation, pour sa part, ne sait que corriger, réprimer et, misérablement, amender le réel, mais non le libérer de ce qui l’entrave. De sorte qu’il y a, pour Fourier, une contradiction fondamentale entre civilisation et réel. Par un retournement paradoxal, ceux qui vivent dans l’irréel ne sont pas ceux qu’on croit, car l’utopie, comprise en son sens péjoratif, consiste bien à croire illusoirement que les effets des contradictions ignorées de la réalité pourraient être supprimés, scientifiquement ou politiquement, sans la claire connaissance de leurs causes encore largement ignorées. Prise en ce sens, l’utopie, avec Fourier, change de camp.
L’utopie se révèle ainsi surtout un « principe de turbulence » [52] au moyen duquel sont identifiés des « possibles latéraux », pour reprendre l’expression de Raymond Ruyer. Un « possible latéral », c’est-à-dire « un possible, à vrai dire "impossible" dans l’actuel, mais qui, n’en est pas moins exigible et nécessaire » [53] et qui, d’autre part, ensemence la « riche frange du virtuel qui accompagne un réel transformé en destin par le cours incontrôlable des choses » - un réel transformé en destin, précisément si l’on n’active pas la vis utopica. Bref, loin d’être une ratiocination de rêveur sublime, l’utopie commande l’action.
Seconde objection fondamentale contre l’utopie : son tropisme totalitaire
Quand on ne considère pas l’utopie comme une rêverie sans prolongement historique, on peut encore la juger dangereuse pour la raison exactement contraire. Ainsi, pour Philippe Nemo, Fourier est un penseur à la fois intéressant et menaçant : « Fourier est un original qui a présenté ses projets de communauté socialiste sous des couleurs extrêmement originales et réellement poétiques ; ses propositions n’en sont pas moins totalitaires » [54]. Le politiste associe d’ailleurs Fourier aux « multiples pervers et infirmes de l’histoire, comme les Frères du Libre-Esprit ou le marquis de Sade » [55]. En somme, les adversaires de l’utopie énoncent toujours, contradictoirement, le même double argument : l’utopie est un projet chimérique conçu par quelque « original » sans méchanceté que certains naïfs s’efforcent pourtant de réaliser ; mais, ce faisant, ils engendrent une société de cauchemar. Le point de vue est ancien. Louis Reybaud, penseur libéral influent, ne disait pas autre chose, déjà sous la monarchie de Juillet : « toutes les chimères se ressemblent et le même sort les attend » [56], comprenons, simultanément, l’échec patent du projet politique et la réussite assurée du malheur des hommes. L’utopiste se retrouve alors prisonnier d’un dilemme dans lequel ses adversaires désirent l’enfermer : ou bien son projet social est irréalisable, ou bien si, par impossible, son projet venait à se réaliser, même partiellement, il ne pourrait engendrer qu’une société intolérable. En somme, accomplir un monde impossible, c’est le rendre d’emblée invivable. Toute utopie se voit alors suspectée, en dépit de ses promesses, de préparer une société de panoptiques et de goulags en raison de son obsession d’homogénéité sociale et de paix civile parfaites.
Dans nombre de ses textes, Miguel Abensour s’est clairement opposé à une telle récusation de l’utopie.
La présupposition de base de cette accusation est une identification entre le mythe de la société réconciliée et l’utopie. Or c’est connaître bien mal l’utopie, car dans la diversité de ses traditions, on peut rencontrer des utopies où est soigneusement préservée la pluralité de la condition humaine, au point de conjurer le fantasme de la société homogène et une, chez Fourier par exemple [57].
C’est donc l’axiome inverse qui est vrai pour Miguel Abensour : « quand l’utopie décroît, le totalitarisme croît » [58]. De fait, comme Martin Buber l’a bien analysé, les utopies post-révolutionnaires sont toutes des réactions à l’idée jacobine selon laquelle on ne peut changer la société qu’à partir de l’État, réactions difficilement compatibles avec l’apologie d’une statocratie inhérente à toute conception totalitaire [59].
De plus, les détracteurs de Fourier qui voient en lui un chantre de l’embrigadement pré-fasciste feignent d’oublier que le concepteur de l’Harmonie cherche, en permanence, à concilier la liberté des individus et un ordre social méticuleusement organisé : « Chaque homme et chaque femme sera absolument libre d’agir à sa volonté et de changer de goût quand il lui plaira ; mais il sera obligé de se ranger dans le groupe affecté à sa passion dominante » [60]. Oui, Fourier pense que l’urbanisme doit être rigoureusement contrôlé, mais les « Palais de la Collectivité » des Harmoniens sont conçus de telle sorte que l’individu est tout autant protégé que la communauté. Oui, en Harmonie, l’argent, la propriété, le luxe, les classes, les titres et les hiérarchies ont été conservés, mais l’organisation autogérée de cette société dispense de tout pouvoir coercitif. Oui, une érotique précise est organisée en Harmonie, mais elle aussi non contraignante, et Fourier rompt avec la plupart des utopies – celles de More et de Campanella notamment – qui imposent des normes sexuelles en établissant de multiples interdits.
Fourier, au fond, selon une formule reprise par Breton, est celui qui a voulu réaliser « l’ordre absolu par la liberté absolue », concevant une société diversifiée à l’extrême où les passions de chaque individu, libérées de toute répression, s’harmonisent pour le bien de tous. Faut-il ici rappeler que l’Ode à Charles Fourier, publiée en 1947, est un poème où se déchiffre sans peine la condamnation des dérives totalitaires du marxisme ? En somme, nous pourrions poser, avec Miguel Abensour, « à l’adresse des pourfendeurs de l’utopie, qu’une société sans utopie, privée d’utopie est très exactement une société totalitaire, prise dans l’illusion de l’accomplissement, du retour chez soi ou de l’utopie réalisée » [61].
Pour Miguel Abensour, toutefois, il y a davantage encore dans l’utopie. Non seulement l’auteur refuse, dans la continuité de Bloch, Adorno et Benjamin, d’assimiler utopie et totalitarisme, ou même de faire de l’utopie une expression par essence anti-politique, mais il montre, de surcroît, que les débats majeurs de la philosophie politique contemporaine se nourrissent d’un retour à l’utopie. Bloch avait, de longtemps, assigné le programme exigeant qui attendait la recherche philosophique face à cet objet singulier qu’est la pensée utopique. « L’utopie toute entière, écrivait-il, coïncide si peu avec le roman politique que c’est à la philosophie dans sa totalité qu’il faut faire appel pour rendre justice au contenu de ce qui est qualifié d’utopique » [62].
Non pas, du reste, que l’utopie doive être comprise, en un paradoxe pour le coup stérile, indépendamment de la fiction, de la littérature et du style. Barthes, parmi les premiers, a bien perçu que la force subversive de Fourier résidait précisément dans le style. Le texte utopique d’un Fourier, en effet, par lui-même, indépendamment de toute réalisation, devient une force critique corrosive et d’autant plus agissante dans l’histoire qu’il est constamment actualisable. C’est aussi que le mode d’écriture de l’utopie est éminemment politique en cela qu’il procède par « voie oblique », selon la formule de Thomas More, c’est-à-dire par cet art d’écrire qui tient compte de la doxa et même des opinions erronées des peuples, intégrées au discours utopique pour être travaillées de l’intérieur même du texte. Miguel Abensour insiste justement sur la pratique des belles lettres qui disposent les Utopiens, déjà dans le texte de Thomas More, à aiguiser leur esprit. « Du même coup, tombe la sempiternelle critique d’après laquelle l’utopie donnerait nécessairement naissance à une société close, repliée sur elle-même, statique, en proie à l’enfermement » [63].
Par la mise en abyme qui nous fait passer alternativement des personnages utopiques aux lecteurs d’utopies, nous en arrivons à comprendre qu’il n’y a d’utopie véritable que celle qui procède à sa propre critique interne, comme on peut le voir clairement chez Joseph Dejacque avec son Humanisphère ou chez William Morris avec ses Nouvelles de nulle part. Tout aussi bien, Miguel Abensour analyse comment Walter Benjamin et Thomas More ont inventé « une relation étrange à l’utopie, faite à la fois de proximité et de distance ou de déplacement, comme si l’utopie était une attitude, une disposition, une forme de pensée, voire un exercice spirituel auquel on ne pourrait se livrer qu’à la condition de maintenir, de ménager une irréductible distance » [64].
On devine alors l’importance que revêt le jeu dans la politique utopiste. L’utopie est peut-être d’ailleurs, au fond, le seul jeu politique véritablement sérieux. Si Fourier, en effet, comprend avec d’autres que toute société est inévitablement conflictuelle, son originalité consiste, confrontée aux conflits internes du corps social, à ne pas chercher à les dépasser, ni même à les circonscrire, mais à les jouer par le truchement de l’écriture utopique.
Le but de l’Harmonie n’est pas de se protéger du conflit (en s’associant par similitude), ni de le réduire (en sublimant, édulcorant ou normalisant les passions), ni encore de le transcender (en "comprenant" l’autre), mais de l’exploiter pour le plus grand plaisir de chacun et sans lésion pour aucun. Comment ? En le jouant : en faisant du conflictuel un texte. [65]
Et qu’est-ce que ce jeu, sinon celui nous permettant de saisir, plus exactement et plus consciemment, l’ordre existant ? Adorno a magnifiquement montré comment « l’irréalité des jeux révèle que la réalité n’est pas encore réelle. Ce sont des exercices inconscients en vue de la vie juste » [66].
Le jeu utopique contribue à l’évidence au maintien du charme de l’existence. Dans un texte magnifique Adorno, citant Hebbel, se demande « ce qui enlève son charme à la vie à mesure que passent les années » [67] . Et Adorno de répondre que le charme, et la séduction qui en résulte, supposent la composition du charme. L’art de combiner, en effet, permet aux charmes et aux séductions de se perpétuer. Or ces derniers constituent, écrit René Schérer, « avec les illusions qu’elles créent, des lignes de fuite ou de résistance, des armes contre la torpeur et l’anéantissement proposées par le règne de la marchandise dont Fourier fut, il y a deux siècles, le premier et le principal pourfendeur. Préserver ce qu’il reste encore de la séduction du monde ou savoir la ressusciter, telle est notre tâche, tel notre combat » [68]. La revendication fouriériste d’une société ludique ne doit donc pas tromper et, surtout, ne pas être confondue avec les plaisirs consuméristes de notre moderne homo festivus. De ce point de vue, Gérard Roche a raison de préciser que les « consternants ébats de la télé-réalité sont loin des vues fouriéristes : le loft apparaissant comme l’antithèse obscène du phalanstère et de l’Harmonie » [69].
________________
Peut-être se souvient-on de ce passage étonnant de Choses vues [70], dans lequel Hugo rapporte un dialogue daté de 1848.
- Ça va mal, a dit Proudhon.
– Quelle cause assignez-vous à tous nos embarras ?
– Pardieu ! tout le mal vient des socialistes !
– Comment ! des socialistes ? mais n’êtes-vous pas un socialiste ?
– Moi, un socialiste, a repris Proudhon, par exemple !
– Ah ça ! Qu’êtes-vous donc ?
– Je suis un financier. [71]
Fourier, lui, ne prétendait pas au titre de financier, ni même à celui d’écrivain, mais tenait fort, en revanche, à celui d’« inventeur » [72] ou bien, au sens où l’entendait Swift, de « projecteur » [73], c’est-à-dire d’homme toujours en projet. Si l’on veut bien accepter cette qualification, en lui conservant son sens swiftien, Fourier pourrait bien être alors le « projecteur » - ou l’un des projecteurs - dont nous avons besoin pour éclairer le marxisme.
Certes, le constat de l’effacement de Marx qui pouvait être énoncé, encore en 2004, par Lucien Sève [74], n’est plus de mise. Toutefois, la thèse soutenue par Lucien Sève alors reste plus que jamais actuelle : la redécouverte de l’auteur du Capital suppose des ajustements critiques et des apports nouveaux, étant entendu que la crise de la pensée de Marx est avant tout la « crise de notre pensée de Marx » [75]. Si penser avec Marx suppose aussi de revisiter les aspects les moins étudiés de son œuvre, de ses sources et de ses prolongements, on peut donc considérer à bon droit que les conceptions fouriéristes mériteraient une étude plus attentive de la part des marxistes. Comme certains marxistes contemporains ont pu le dire à propos de Marx lui-même [76], il s’agirait alors moins d’opérer un retour à Fourier que de faire un détour par Fourier.
En tout cas, pour reprendre une dernière fois la lumineuse formule de Bloch, « quelque chose manque » dans les études marxistes, eu égard à ce que la pensée utopique de Charles Fourier pourrait lui apporter. Et on se souviendra ici que Benjamin propose une manière originale et féconde de définir le progrès. « Il faut fonder, écrit-il, le concept de progrès sur l’idée de catastrophe. Que les choses continuent comme avant, voilà la catastrophe » [77]. Souhaitons aux études marxistes, de ce point de vue, un avenir un peu moins « catastrophique », sans qu’il soit besoin, à rebours, de statufier Fourier. Ce qui serait sans doute une manière de donner raison à la poétique prophétie de Breton.
Fourier on s’est moqué mais il faudra bien qu’on tâte un jour bon gré mal gré de ton remède Quitte à faire subir à l’ordonnance de ta main telles corrections d’angle. [78]
